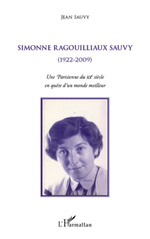
Mourir… Voilà.. Ma mère est morte… La vie s’en était donc allée comme elle était venue.
A la tristesse se mêle une forme de soulagement. Depuis de nombreuses années, la maladie d’Alzheimer m’avait enlevée ma mère. La mort me la rend aujourd’hui. A nouveau, je peux lui parler. A nouveau, je peux lui dire lui dire et lui écrire combien je l’ai aimée, combien je l’aime encore. Avec les tourments de la passion d’un fils qui aime sa mère et la déteste aussi. Amour, haine… l’endroit, l’envers d’une même médaille… J’ai failli y laisser ma peau mais j’ai pu accepter de faire face à ces sentiments si violents dans leur ambivalence. Au cours de ma construction lente et tardive d’adulte responsable, j’ai pu apprendre à faire le tri, accepter, pardonner, comprendre. Comprendre à quel point elle aussi avait du batailler avec elle-même, avec les autres.
Dans une sorte de mélopée lancinante – douloureuse à entendre -, elle appelait souvent sa maman. A quelques minutes de sa mort, elle l’appelait encore. Cet appel portait la trace d’une blessure profonde, celle du petit enfant n’ayant pas reçu assez d’amour de ses parents qui ont fait ce qu’ils ont pu mais n’ont pas forcément pu beaucoup. Sa mère Blanche, ouvrière coupeuse de chaussure qui l’avait confiée à ses grands parents pendant plusieurs années. Son père Eugène qui préféra Georges, le frère cadet et le fils qu’il aurait peut-être aimé qu’elle soit. Simone eut sans doute du mal à trouver sa place dans cette famille à l’esprit étroit qui ne sut pas répondre à ses aspirations pour la musique ou les études. Au sortir de l’enfance, chacun porte des valises plus ou moins lourdes. Celles de maman n’étaient pas légères. Elle s’alourdirent un peu plus avec la guerre. Et la perte de cette amie juive, sa meilleure amie cachée dans le petit studio parisien, retrouvée par les allemands puis jamais revenue de camps de concentration.
Ensuite il y eut toute une vie, toute sa vie : la rencontre avec mon père, l’Afrique, ma naissance, les différents épisodes de notre petite famille singulière, l’arrivée insidieuse de la maladie, le sacerdoce de mon père omniprésent à ses côtés jusqu’au dernier jour, les passages dans des différents établissements soi-disant spécialisés mais sans humanité, le refuge trouvé enfin à Claire Demeure.
Comment la décrire ? Peut-être avant tout parler de sa singularité, de ce caractère entier, intransigeant, trempé dans un métal en fusion, de sa vie intellectuelle intense, de ses multiples incursions dans des domaines variées : le trotskysme, la pédagogie, la sémantique générale, la macrobiotique, la musique, l’ésotérisme. Je rends hommage à cette curiosité pour les choses improbables, à son écriture irréprochable qui m’a donné le goût de la chose écrite et l’amour de notre langue.
Au moment de cet adieu, je ne veux pas taire non plus son caractère impossible, ses sautes d’humeur, ses migraines, la violence des nombreuses gifles infligées à l’enfant difficile que je fus et que ne n’ai pu comprendre qu’en devenant parent à mon tour. Je n’oublie rien non plus du mépris dont elle a fait preuve à l’égard des femmes de ma vie. Bénéfice paradoxal de cette putain de maladie, cette difficulté relationnelle s’estompa dans ses dernières années. Par-delà la communication verbale dont elle n’était plus capable, se fit jour un être doué d’empathie qui aura su se faire aimer. Finalement.
Peut-être trop cruelle, la vérité d’un fils blessé ne saurait cacher l’amour et l’admiration lucide pour le parcours de vie de Simone Sauvy, ma mère à jamais.
Olivier Sauvy – Paris, 15 novembre 2009
